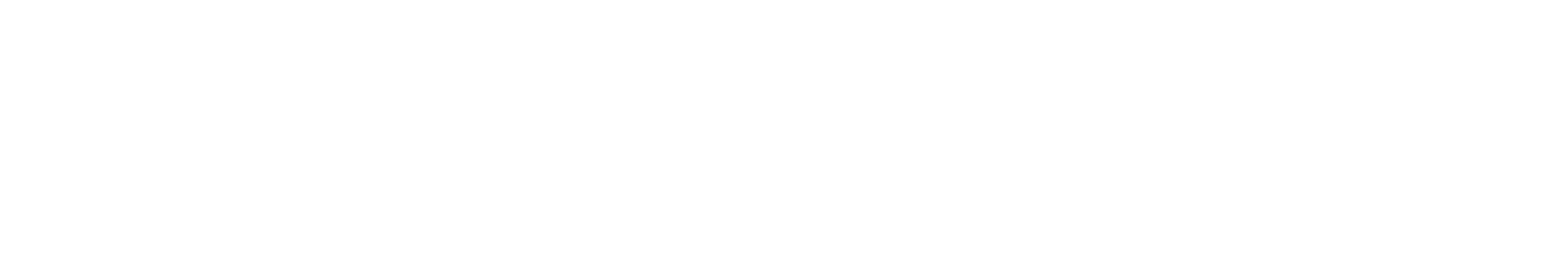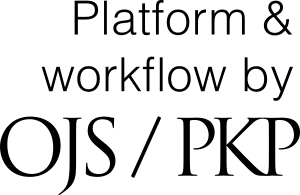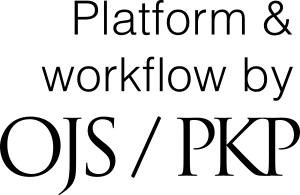Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique (RHCA) est une revue open access d’histoire de l’Afrique à comité de lecture. La revue publie deux numéros thématiques par an et propose différentes rubriques : articles varias, comptes rendus de lecture, entretiens, et sources, terrains & contextes.
Appel à contributions - n°11 Retour(s) en Afrique
Appel à propositions pour la revue Sources. Matériaux & terrains en études africaines et la Revue d’histoire contemporaine de l’Afrique (RHCA). Coordination : Giulia Bonacci (IRD) et Céline Labrune-Badiane (ITEM).
Alors que l’année 2025 est placée par l’Union africaine sous le signe de « la justice pour les Africains et les descendants d’Africains à travers les réparations » et que des États africains, discutent et se dotent de lois visant à faciliter l’accès à la nationalité pour les Afro-descendant·es, dont le Bénin tout récemment, il semble important de revenir sur une dimension souvent implicite et peu documentée de ces mobilisations, celle des migrations d’Afro-descendant·es en Afrique, communément identifié·es par les termes Back to Africa.
Les États africains sont devenus des acteurs de premier plan de ces mobilisations liées au retour. Ce faisant, ils ont pris le relais des formations sociales, politiques, religieuses et culturelles – à l’instar de la Universal Negro Improvement Association (UNIA), fondée en 1918 à New York par Marcus Garvey – qui dans les diasporas revendiquaient depuis longtemps leur droit à un retour en Afrique. En effet, l’idée de retour en Afrique est intimement associée à celle des réparations au titre de l’esclavage et du colonialisme. Son étude contribue dès lors aux débats actuels sur les séquelles des injustices causées par la traite atlantique, la colonisation et le racisme systémique dans les sociétés post-esclavagistes et post-coloniales (Araujo 2017, Beckles 2013). De fait, le droit au retour est un des dix points du plan pour les réparations, promulgué en 2014 par le CARICOM, l’organisation des États de la Caraïbe. C’est pourquoi le retour relève des relations historiques entre l'Afrique et ses diasporas autant que d’enjeux politiques très contemporains plus globaux. Ce double numéro associant Sources et la Revue d’histoire contemporaine de l’Afrique invite à l’étude et à la discussion de l’idée et des pratiques du retour en Afrique, depuis et vers différents territoires, depuis la fin du XVIIIe siècle. L’objectif est de contribuer, à partir de données théoriques et empiriques, à la réflexion sur les reconfigurations en cours des liens entre le continent africain et les diasporas africaines dans le monde.
Brève présentation des deux revues
Sources. Matériaux et terrains en études africaines
La revue Sources se donne pour mission de rendre accessibles les textes, images, sons, entretiens, notes de terrain et tout type de documents qui constituent les matériaux à partir desquels chercheuses et chercheurs élaborent leurs analyses. Les articles publiés peuvent s’inscrire dans des champs disciplinaires variés (anthropologie, littérature, sciences politiques, histoire, géographie, etc.) et constituent des archives de la recherche de terrain, tout en proposant des analyses sur les contextes de production et de circulation de ces matériaux, ainsi que des réflexions sur les enjeux de l’accès aux sources en Afrique, notamment textuelles, iconographiques, cartographiques et ethnographiques. Il est attendu des autrices et des auteurs proposant un article de mentionner explicitement, dès la soumission de leur résumé, les documents collectés pendant l’enquête qui seront ainsi partagés (archives publiques ou privées, productions écrites locales, extraits d’entretiens, notes de terrain, cartes et croquis produits par la·le chercheur·e ou par ses interlocuteurs, enregistrements audio et/ou visuels, etc.). L’équipe de la revue accompagne ensuite chaque article, y compris dans la préparation des matériaux, pour les rendre conformes aux principes dits FAIR (rendre les matériaux « trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables »), dans l’objectif de réduire les asymétries dans l’accès au savoir.
Revue d’histoire contemporaine de l’Afrique
La Revue d’histoire contemporaine de l’Afrique (RHCA) est une revue en accès ouvert d’histoire de l’Afrique qui a pour objet l’histoire contemporaine du continent africain, affirmant la richesse et la complexité de ses trajectoires, à travers des travaux principalement centrés sur les dynamiques contemporaines, en particulier du XIXe siècle à nos jours. Loin de constituer un quelconque repli « disciplinaire », linguistique ou culturel quant à l’étude des dynamiques du continent africain, la revue s’intéresse aux faits plus ou moins récents qui en éclairent les dynamiques actuelles, sans faire l’impasse sur leurs origines plus anciennes. Certains découpages chronologiques structurent plus que d’autres nos imaginaires et nos manières d’appréhender les réalités historiques, en particulier le moment colonial, de la phase de « conquête » aux indépendances. Mais moins qu’une réalité politique intangible, la périodisation usuelle de l’histoire de l’Afrique – précoloniale, coloniale, postcoloniale – est aussi le fruit d’une construction scientifique qui doit être questionnée. Le défi est alors double. D’une part, il s’agit de penser de manière critique les mécanismes – économiques, politiques, institutionnels et disciplinaires – qui permettent de se jouer des chronologies classiques. Il s’agit de sortir du nationalisme méthodologique et de contribuer à une narration multiple des faits et à une histoire des processus, aboutis ou non. D’autre part, il est nécessaire de reconsidérer les découpages géographiques, de cesser de penser séparément l’Afrique d’un contexte plus global, dans une nécessaire attention aux dynamiques régionales ou internationales qui placent le continent au cœur de recompositions complexes, multiples et connectées.
Définir le(s) retour(s) en Afrique
L’idée d’un « retour » en Afrique est mobilisée depuis longtemps et de multiples manières dans les espaces marqués par l’histoire de la traite atlantique et inscrits dans les géographies coloniales et postcoloniales. Parfois, cette idée se traduit en mobilisations, en pratiques sociales et culturelles, et en mobilités vers le continent africain. S’il existe des variations selon les périodes et les lieux, les « retours » en Afrique ont en commun de n’être pas simplement un retour physique ; ils s’inscrivent aussi dans une démarche politique et induisent une volonté de réappropriation d’un héritage africain ancestral, indépendamment du cadre idéologique et institutionnel (Redkey 1969, Jenkins 1975, Prah 2009, 2012). Mis à l’épreuve des sociétés africaines, le « retour » soulève alors d’autres questions, relatives au statut des étrangers, aux enjeux économiques, et contribue à la redéfinition de projets politiques et culturels, simultanément locaux et transnationaux. Souvent peu visible car il engage un nombre restreint de personnes (quelques dizaines à plusieurs centaines selon les lieux et les périodes), le retour saisit néanmoins des imaginaires anciens qui sont affectés par les contextes de départ, dans les sociétés post-esclavagistes, et par les contextes d’arrivées, dans les États coloniaux puis postcoloniaux en Afrique. Au seuil du XXIe siècle, ces dynamiques se transforment, notamment sous l’influence des diasporas africaines plus récentes, qui tissent leur « retour » au pays avec d’autres outils, langues et médias.
Ce double numéro porte sur l’histoire des idées, pratiques, enjeux et contours du retour sur la longue durée, dans des espaces marqués par l’histoire de la traite et de la colonisation européenne. Il vise à saisir les transformations politiques et sociales qui les font évoluer : qu’est-ce qui différencie ou lie des expériences de retour conduites dans des temps et espaces différents ? Est-ce que le « retour » d’une militante garveyite africaine-américaine* (Gaines 2008, Meriwether 2002) est comparable à celui d’un administrateur colonial antillais ou guyanais dans les colonies françaises en Afrique (Hélénon 2011) ? Dans ses romans, la Guadeloupéenne Maryse Condé raconte l’incongruité d’un « retour » effectué en tant qu’enseignante dans le cadre de la coopération entre la France et ses anciennes colonies africaines (Labrune Badiane 2019). Une ambiguïté que l’on peut retrouver auprès des Haïtiens au Congo (Kuyu 2006) ou des Cubains en Angola (Hatzky 2015). Qu’est-ce qui distingue le « retour » d’un rastafari jamaïcain en Éthiopie (Bonacci 2010) ou en Tanzanie (Bedasse 2017) de celui d’un « repat », professionnel ou investisseur né de parents ivoiriens en France et installé au Sénégal (Quashie 2024) ? Quels réseaux, formations sociales, entreprises commerciales et dispositifs administratifs naissent dans le sillage du « retour » ? Quels rôles jouent les États africains postcoloniaux dans ces retours diasporiques ? Quels statuts, quelles carrières, et quelles identités, individuelles ou familiales, se voient (re)définis par l’expérience du « retour » ? Que se passe-t-il une fois retrouvée la terre d’origine, qui n’en est pas toujours une ? Joie, peur, déception, émerveillement… quelles émotions suscitent l’arrivée sur le continent et plus largement la rencontre avec l’Afrique ? Comment est vécue la confrontation entre imaginaires, attentes et réalité ?
Nous invitons des contributions documentant et réfléchissant à ce qui constitue l’histoire politique, sociale et culturelle du retour en Afrique du XIXe au XXIe siècle. Si les premières revendications et mobilisations en faveur du retour en Afrique sont formulées et produites dans les sociétés esclavagistes des Amériques dès le XVIIIe siècle, nous nous concentrerons ici sur les pratiques de la période dite contemporaine. Il s’agit aussi de s’intéresser à ses contours ainsi qu’à l’évolution des termes, de l’idée et des pratiques sociales qui y sont associés et qui se sont diversifiés, comme le souligne l’usage du pluriel dans le titre de cet appel.
Le retour et les études africaines
Il n’est pas anodin que cet appel soit porté par deux revues d’études africaines. Alors que l’étude du retour en Afrique a longtemps été cantonnée – à tort – aux Amériques, notre initiative veut contribuer à « raccrocher » l’histoire africaine à celle des diasporas afin de penser une histoire partagée entre ces espaces. Le retour ou « rapatriement » est bien sûr déjà sujet des sciences sociales : déplacés de guerre, réfugiés, migrants et exilés, en Afrique ou ailleurs, ont en partage les (im)possibilités d’une prise en charge pour une réinstallation dans le territoire quitté. Néanmoins, les retours qui nous intéressent dans le cadre de ce double numéro trouvent l’origine de leur premier déracinement dans la matrice de l’esclavage atlantique, une expérience historique qui fit circuler pendant plusieurs siècles plus de 12 millions d’Africains et d’Africaines asservi·es vers les Amériques. Le retour en Afrique est ainsi l’une des idées constantes – quoique souvent marginale – ayant structuré la pensée politique, religieuse, sociale et culturelle noire déployée aux Amériques. Alors que de nombreux travaux d’histoire, d'anthropologie et de sociologie étudiaient ces communautés noires aux Amériques dans leur grande diversité, le champ d’étude des diasporas africaines s’est ouvert au milieu des années 1960, pour saisir les dynamiques globales liant l’Afrique et ces populations afro-descendantes dans le monde atlantique et au-delà (Shepperson 1993, Harris 1993, Gilroy 1993). Dans l’historiographie ayant trait à la définition ou aux caractéristiques des diasporas africaines, le « retour en Afrique » est un sujet de prédilection car il informe directement la nature et la forme de celles-ci (Butler 2001, Zeleza 2005). Pour autant, si l’on trouve des « retourné·es » dans de nombreuses sociétés africaines, ils et elles passent souvent « sous le radar » des chercheur·es. Comme si nos lunettes locales, régionales ou nationales nous empêchaient de voir et reconnaître ces mobilités, ces retours, ces engagements diasporiques en Afrique, nécessairement transnationaux, et peut-être plus largement, l’impact des internationalismes noirs sur le continent.
Pour inscrire la thématique du retour dans les études africaines, et par conséquent pour articuler celles-ci avec l’étude des diasporas africaines, il s’agit d’opérer une bascule méthodologique afin d’ajouter à l’idée de retour (centrée aux Amériques), l’étude de ses pratiques sociales (centrées sur le continent), par la reconstitution des trajectoires dans leur intégralité, depuis les sociétés de départ jusque dans les sociétés d’accueil. Cette bascule engage nécessairement les sources et les contextes des sociétés africaines et trouve ainsi toute sa place dans ces deux revues, Sources et RHCA. Ce double numéro a ainsi pour ambition de renforcer le dialogue entre études africaines et études diasporiques, qui se développe encore timidement, en particulier dans le monde francophone. Les deux revues invitent d’ailleurs des articles écrits dans des langues variées (français, anglais, portugais) et des traductions sont possibles, y compris vers d’autres langues du continent africain lorsque cela est pertinent (revue Sources).
Axes et perspectives
Si l’idée de retour en Afrique est documentée dès les prémices de la traite atlantique, c’est aux XVIIIe et XIXe siècles que des colonies de peuplement d’esclaves affranchi·es britanniques et afro-américains se sont développées en Sierra Leone et au Liberia (Campbell 1993, Clegg 2004). Des Africain·es « libéré·es » (liberated Africans) se sont aussi installés sur la côte kényane (Harris 1987) et des descendant·es d’esclaves au Brésil, les Agudas, sont retournés au Bénin, au Togo ou encore au Nigéria (Yai 1997, Prah 2009). Il s’agit ainsi de se demander d’une part si les abolitions de la traite et de l’esclavage, égrenées au fil du XIXe siècle, ont contribué à l’émergence et la reformulation du désir de retour ; et d’autre part, comment la colonisation, les décolonisations et la naissance des États africains modernes, au long du XXe siècle, transforment les conditions d’accueil des « retourné·es ». Il s’agira enfin d’interroger des mobilités plus récentes, notamment celle des « repats », à l’aune des expériences historiques du retour en Afrique.
Les contributions attendues peuvent relever de l’histoire, de l’anthropologie, de la sociologie, de la littérature ou des sciences politiques. Les données relatives aux espaces non anglophones, moins documentés, sont particulièrement encouragées, ainsi que les travaux sur d’autres régions que l’Afrique de l’Ouest, souvent sur-représentée. Quatre axes de réflexion sont proposés afin de guider et d’organiser les propositions d’articles.
1. Imaginaires et idéologies du retour
Pour contrer l'inévitable oubli de la terre d’origine à mesure du temps qui passe, des imaginaires sociaux se sont déployés et ont produit des représentations de l’Afrique, de nouvelles filiations africaines et des revendications au droit à un retour. Nous invitons les auteur·ices à questionner les imaginaires que révèle cette revendication du retour ainsi que les grands cadres politiques, intellectuels, culturels, sociaux et religieux au sein desquels elle s’inscrit, par exemple l’éthiopianisme ou le panafricanisme. Quels rôles jouent les créations artistiques, musicales et littéraires dans la transmission et la diffusion de ces imaginaires sociaux ? Comment l’idée ancienne d’une responsabilité particulière des Afro-descendant·es dans la « régénération », la « renaissance » ou encore le développement de l’Afrique se reformule-t-elle dans des contextes transformés et quels projets politiques en découlent ? Comment les États appréhendent-ils un désir de retour qui exprime une critique radicale des sociétés post-esclavagistes et postcoloniales, là où les Afro-descendant·es subissent encore racisme et discriminations ? Quelles sources et archives informent les enjeux soulevés par le désir, la possibilité ou le projet du retour ?
2. Mobilités et mises en pratique
Cet axe invite à explorer la manière dont ces retours sont réalisés concrètement, depuis et vers des lieux variés, et la façon dont les acteurs et actrices définissent leurs expériences. Il s’agira d’identifier les étapes concrètes de ces retours depuis leurs lieux de provenance, notamment les moyens mobilisés en amont et le rôle des associations, programmes, forums, ou entreprises qui visent à faciliter l’installation en Afrique. Ceci est d’autant plus significatif en l’absence d’accord international, d’apparatus juridique ou d’instrument financier dédiés au retour des descendant·es d’Africaines et d’Africains. Quelles sources permettent de saisir les motivations de ces migrant·es et comment peuvent-ils et elles être identifié·es, une fois arrivé·es en Afrique ? Il s’agit aussi de réfléchir à l’importance et les difficultés d’accéder à ces voix pour documenter le retour. En effet, la dimension radicale de cette mobilité, souvent le produit d’une conscience raciale et politique déployée à contre-courant, et l’illégalité dans laquelle ces « retourné·es » se trouvent parfois, peuvent compliquer la collecte de leurs récits.
3. L'accueil des retourné·es dans les sociétés africaines
Le rôle joué par les sociétés d’accueil est équivoque et se déploie sur un arc touchant aux relations locales, situées au « ras du sol », passant par les corps intermédiaires, locaux ou transnationaux et engageant la structure et les outils de l’État. Cet axe vise à examiner les relations que les « retourné·es » tissent avec les sociétés africaines, les manières dont ils et elles sont perçu·es par des populations souvent soumises à une pression migratoire très forte, les représentations qui se font jour, de part et d’autre, ainsi que les reconfigurations identitaires et raciales que ces rencontres produisent. On peut notamment se demander quelles sont les pratiques d’accueil des « retourné·es » hors des cadres de l’État, par exemple à l’initiative d’églises ou de la société civile, d’associations ou d’organisations, et comment les définir. Pour les périodes les plus récentes, est-ce que l’irruption du retour, mis en scène sur de nouveaux réseaux sociaux, transforme ses formes et son impact social ? Il s’agit aussi de documenter les différents statuts juridiques proposés par les États africains : sont-ils liés au développement de politiques vis-à-vis de leurs diasporas nationales ? En fait, quels sont les usages politiques et économiques par les États africains des engagements diasporiques ? Quelles sont les initiatives et politiques d'accueil diasporique mises en place par les États du continent africain ? Comment saisir cette perspective africaine du retour ?
4. Epistémologies du retour
Étudier les dynamiques et les enjeux du retour en Afrique éclaire d’un nouveau jour les relations historiques entre l’Afrique et ses diasporas sur la longue durée et permet d’entrevoir leurs futurs possibles. Ce champ reste encore peu exploré par les sciences sociales, car, d’une part, pour celles et ceux qui travaillent sur les diasporas des Amériques, le retour représente un refus de l’hybridité qui caractérise les sociétés créoles et d’autre part, il est parfois tenu pour insignifiant dans les études africaines du fait de l’ampleur limitée du phénomène. Pourtant, en centrant l’analyse sur le retour, c’est une interface dense et riche qui apparaît, située à la rencontre entre l’Afrique et ses diasporas, à l’intersection de grandes aires culturelles et transnationales. Dès lors plusieurs questions méthodologiques se font jour : comment documenter ces trajectoires transnationales qui passent le plus souvent sous les radars dès lors que le statut d’afro-descendant peine à être reconnu par les pays africains ? Comment accéder aux voix de celles et ceux qui en font l’expérience et de celles et ceux qui les accueillent ? Comment créer un dialogue entre des données issues de contextes sociolinguistiques et historiques différents ? Comment des matériaux issus des sociétés africaines peuvent-ils informer les connaissances sur les diasporas africaines ? Et inversement, dans quelle mesure la prise en compte de l’expérience diasporique peut-elle informer les connaissances produites sur l’Afrique ? Comment déployer des concepts centraux de l’histoire du retour, comme la race, la nationalité, ou la souveraineté dans des espaces marqués par des expériences socio-historiques variées ? En quoi articuler étude des diasporas et étude de l’Afrique contribue à la redéfinition des identités, frontières et territoires en Afrique ? Où la question du retour en Afrique se situe-t-elle dans les débats publics et internationaux autour des réparations au titre de l’esclavage et du colonialisme et des restitutions des objets pillés sur le continent ? Dans quelle mesure est-ce que ces questions dessinent le futur des reconfigurations en cours liant le continent africain et le monde ?
Envoi des propositions
Les propositions d’articles devront être inédites, longues de deux pages maximum (avec bibliographie indicative), en français ou en anglais, et accompagnées d’une courte biographie du·de la ou des auteur·e(s) dans un seul document (format DOCX, DOC ou ODT) comprenant votre adresse mail. Ce résumé devrait inclure une présentation précise des sources ou matériaux. Les articles devront comporter en moyenne 45 000 signes (y compris espaces, bibliographie, résumé et mots-clés).
- RHCA : Nous acceptons également des entretiens (35 000 signes) avec des personnalités qui pourraient parler de leurs expériences de retour avec une profondeur historique ainsi que de comptes rendus d’ouvrages en lien avec cette thématique (5 000/15 000 signes). Retrouvez les consignes aux auteur·es RHCA ici. Les articles seront publiés en français.
- Sources : Les textes pourront être publiés en français, en anglais ou en portugais et des traductions totales ou partielles vers d’autres langues africaines sont possibles au cas par cas.
Merci de consulter les règles de sélection des textes et les conditions de publication, et les instructions aux auteurs.
Calendrier
- 15 mars 2025 : publication de l’appel (français, anglais, portugais)
- 15 mai 2025 : date limite de réception des propositions aux adresses suivantes : giulia.bonacci@ird.fr et celine.labrunebadiane@gmail.com
- 1er juin 2025 : Notification aux auteur·es des propositions retenues.
- 15 octobre 2025 : date limite d’envoi des articles
- Octobre 2026 : publication du double numéro Sources / RHCA
Références
Araujo, Ana L. 2017. Reparations for Slavery and the Slave Trade. A Transnational and Comparative History. Londres : Bloomsbury.
Bedasse, Monique. 2017. Jah Kingdom. Rastafarians, Tanzania, and Pan-Africanism in the Age of Decolonization. Chapel Hill, NC : The University of North Carolina Press.
Beckles, Hilary. 2013. Britain’s Black Debt, Reparations for Caribbean Slavery and Native Genocide. Kingston : The University of the West Indies Press.
Bonacci, Giulia. 2010. Exodus ! L’histoire du retour des Rastafariens en Éthiopie. Paris : L’Harmattan.
Butler, Kim D. 2001. « Defining Diaspora, Refining a Discourse ». Diaspora: A Journal of Transnational Studies, 10, n° 2 : 189-219.
Campbell, Mavis C., dir. 1993. Back to Africa: George Ross and the Maroons: From Nova Scotia to Sierra Leone. Trenton, NJ : Africa World Press.
Clegg, Claude A. 2004. The Price of Liberty: African Americans and the Making of Liberia. Chapel Hill : University of North Carolina Press.
Ebron, Paulla. 1999. « Tourists as Pilgrims: Commercial Fashioning of Transatlantic Politics ». American Ethnologist 26, n° 4 : 910-932.
Gaines, Kevin K. 2008. American Africans in Ghana: Black Expatriates and the Civil Rights Era. Chapel Hill, NC : The University of North Carolina Press.
Gilroy Paul. 1993. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. New York : Verso.
Harris, Joseph E., dir. 1993. Global Dimensions of the African Diaspora. Washington, D.C. : Howard University Press.
Harris, Joseph E. 1987. Repatriates and Refugees in a Colonial Society. The Case of Kenya. Washington D.C. : Howard University Press.
Hatzky, Christine. 2015. Cubans in Angola. South-South Cooperation and Transfer of Knowledge 1976-1991. Madison : The University of Wisconsin Press.
Hélénon, Véronique. 2011. French Caribbeans in Africa: Diasporic connections and Colonial Administration, 1880-1939, New York : Palgrave Macmillan.
Jenkins, David. 1975. Black Zion: The Return of Afro-Americans and West Indians to Africa. Londres : Wildwood House.
Kuyu, Camille. 2006. Les Haïtiens au Congo. Paris : L’Harmattan.
Labrune Badiane, Céline. 2019. « ‘Afrique où es-tu ?’ : L’expérience africaine de Maryse Condé ». In Mélanges en l’honneur de Maryse Condé, dirigé par Laura Cassin, 163-177. Pointe-à-Pitre : Presses universitaire des Antilles.
Shepperson, George. 1993. « African Diaspora: Concept and Context ». In Global Dimensions of the African Diaspora, dirigé par Joseph Harris, 46-53. Washington, D.C. : Howard University Press.
Prah, Kwesi K., dir. 2009. Back to Africa, volume 1: Afro-Brazilian Returnees and their Communities. Cape Town : CASAS.
Prah, Kwesi K., dir. 2012. Back to Africa, volume 2: The Ideology and Practice of the African Returnee Phenomenon from the Caribbean and North-America to Africa. Cape Town : CASAS.
Quashie, Hélène. 2024. « De la minorisation raciale en France à la blanchité sociale au Sénégal. Paradoxes postcoloniaux de l’articulation classe-race dans les circulations privilégiées de la diaspora noire ». Critique internationale, n° 105 : 107-130.
Yai, Olabiyi B. 1997. « Les ‘Aguda’ (Afro-Brésiliens) du Golfe du Bénin ». Lusotopies, n° 4 :275-284.
Zeleza, Paul T. 2005. « Rewriting the African Diaspora: Beyond the Black Atlantic ». African Affairs 104, n° 414 : 35-68.
* Ici, le terme « Africain-Américain » désigne les populations noires aux États-Unis, alors que le terme « Afro-Américain » désigne plus largement les populations noires aux Amériques. Le terme « Afro-descendant » peut également englober les descendant·es des migrations africaines coloniales et postcoloniales.