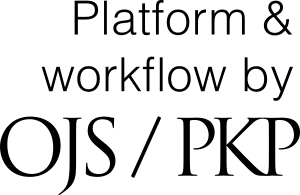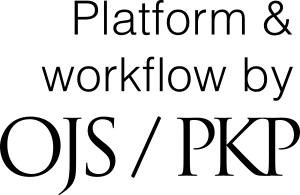Recherche participative sur la déficience visuelle : Analyse des modalités de participation de l’étude Homère
DOI :
https://doi.org/10.5077/journals/rihv.2024.e1611Mots-clés :
Sciences participatives, Étude de cas, Retour d’expérience, Handicap, Enquête en ligneRésumé
La recherche participative se révèle particulièrement pertinente dans le domaine du handicap en raison de ses potentielles répercussions sur la vie des personnes concernées et leur pouvoir d’agir. Cet article vise à décrire la mise en œuvre du processus participatif de l’étude Homère, une enquête en ligne visant à documenter la vie quotidienne des personnes ayant une déficience visuelle vivant en France. Une approche par étude de cas via l’analyse des documents produits pour la conduite de l’étude a été réalisée pour décrire les différentes phases de l’étude, et notamment les interactions entre actrices et acteurs de terrains et de la recherche. Les résultats illustrent la valeur ajoutée de l’implication des personnes de terrain, mais montrent également les défis de la recherche participative. Ils permettent de formuler des recommandations pouvant être appliquées à d’autres études participatives.
Article soumis à la RIHV à la suite de la présentation lors de la journée scientifique « Handicap visuel et participation sociale : les apports de la recherche » de la Fédération pour la Recherche sur le Handicap et l’Autonomie (FEDRHA, https://fedrha.fr/ ) le 10 octobre 2023. Cette journée a été co-organisée par l’unité de recherche Développement, Individu, Processus, Handicap, Éducation (DIPHE) de l’Université Lumière Lyon 2, le Laboratoire Ergonomie et Sciences Cognitives pour les Transports (Lescot), ainsi que le l aboratoire Mobilité Durable, Individu, Société (MODIS) de l’Université Gustave Eiffel.
Introduction
En 2021, la part estimée de personnes ayant une déficience visuelle en France, où la présente étude a été réalisée, était d’un peu plus de 2 % (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, DREES, 2023). Dans le contexte de vieillissement de la population, cette prévalence devrait s’accroître dans les prochaines années, la déficience visuelle concernant davantage les personnes âgées (Burton et al., 2021). La vision étant particulièrement utilisée pour accéder au contenu écrit, pour interagir avec les autres et s’orienter dans l’espace, la présence d’une déficience visuelle peut conduire à tous les âges de la vie à des situations de handicap, en particulier lorsque l’environnement n’est pas adapté. Par exemple, la présence d’une déficience visuelle est associée à une restriction de l’accès à l’éducation (Simui et al., 2018) et à l’emploi (Bell & Silverman, 2018), d’une réduction de la mobilité (Douglas et al., 2012), de la qualité de vie (Assi et al., 2021), de la santé physique (Jones et al., 2010) et mentale (Augestad, 2017 ; Renaud & Bédard, 2013).
En France, les ressources financières et humaines dédiées aux personnes qui ont des incapacités ne répondent pas adéquatement aux besoins, malgré leur accroissement depuis la loi sur le handicap du 11 février 2005. En effet, les mesures gouvernementales se concentrent principalement sur la déficience, sans chercher à favoriser une transformation de la société pour la rendre plus accessible, et inclusive (Conseil de l’Europe, 2023 ; le Défenseur des droits, 2020). Or, selon les modèles interactionnels du handicap, ce dernier est davantage ou au moins en partie causé par des obstacles environnementaux physiques et sociaux, qui constituent des freins à la participation sociale des personnes qui ont des incapacités. Par exemple, le Modèle de développement humain – Processus de production du handicap (MDH-PPH) de Fougeyrollas et al. (1998) et la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF) de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé, 2001) décrivent les interactions entre les caractéristiques individuelles et celles de l’environnement comme source de handicap. L’interaction entre les limitations individuelles et les barrières créées par la société comme source de handicap est sollicitée également dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’ONU (Organisation des Nations unies, 2006).
Dans cette même perspective, la recherche dite traditionnelle peut contribuer à “handicaper” davantage les personnes concernées plutôt qu’améliorer leurs conditions de vie (Oliver, 1992), car n’être considérés que comme sujets d’étude peut être source d’aliénation et de perte de pouvoir (Kitchin, 2000). Dès les années 70, de nouveaux courants pluridisciplinaires de recherches comme les Disability Studies vont apparaître pour défendre un type de recherche plus participatif et engagé. Date de la même époque le slogan “Nothing about us without us” des militants des droits des personnes handicapées, revendiquant la volonté d’être associés aux prises de décision qui pourraient avoir un effet sur leur propre vie.
La recherche participative, et l’ensemble des approches désignées par les terminologies recherche-action, recherche-intervention, recherche en partenariat ou partenariale, recherche collaborative ou coopérative, recherche démocratique, recherche critique, recherche pragmatique, recherche émancipatoire, co-recherche, sciences citoyennes, sciences collaboratives, ou encore community based research (Anadón, 2007 ; Houllier & Merilhou-Goudard, 2016), s’inscrit dans une volonté de bâtir des ponts entre science et société, et entre théorie et pratique (Anadón, 2007). Ces approches sont particulièrement pertinentes dans le champ du handicap puisqu’elles permettent d’améliorer directement les conditions de vie des personnes concernées et d’accroître leur pouvoir d’agir et leur émancipation (Barnes, 2003). Caractérisée par l’implication des personnes concernées et des autres parties prenantes dans le processus de recherche, la recherche participative s’appuie sur leur expérience et leurs savoirs (Reason & Bradbury, 2008), et ce idéalement à toutes les étapes : identification des besoins, problématisation, idéation de projets, recueil de données, analyse et mobilisation des connaissances produites. En plaçant les personnes concernées, les membres d’une communauté et/ou les décideurs au cœur du processus, la recherche participative permet de problématiser autrement, de viser la production de savoirs dirigés vers leurs priorités, et d’entraîner le développement de solutions potentiellement plus innovantes, utiles, durables et efficaces (Latulippe et al., 2023 ; Northway, 2010 ; Nyström et al., 2018 ; Priestley et al., 2010).
Avec son double objectif de changement social et de rigueur scientifique, la recherche participative est ambitieuse par nature et comporte plusieurs défis, à commencer par celui d’assurer la collaboration entre personnes de statuts et de milieux différents (Bertrand & Petiau, 2023). Il devient ainsi nécessaire de documenter la manière dont se déroule concrètement la recherche participative, afin de partager les succès, mais aussi les difficultés rencontrées et les solutions mises en œuvre pour les résoudre (Bertrand & Petiau, 2023).
Dans le champ de la déficience visuelle, une recherche participative récente, nommée « étude Homère », a été réalisée avec l’objectif de documenter les situations de vie, les ressources et les difficultés des personnes ayant une déficience visuelle vivant en France, par le biais d’une enquête en ligne, elle-même construite dans une démarche participative. L’objectif du présent article est de décrire la mise en œuvre de cette étude, en particulier les modalités d’interactions entre ses différents acteurs et actrices, et d’identifier des facilitateurs et des obstacles à sa réalisation.
Méthode d’analyse de la démarche participative
Le présent article repose sur une approche par étude de cas, qui offre une méthodologie flexible pour la description et l’analyse approfondie d’un phénomène dans son contexte naturel (Rosenberg & Yates, 2007). L’objectif est de documenter la façon dont la démarche participative s’est matérialisée dans le cadre de l’étude Homère. L’approche par étude de cas est pragmatique, permet de rendre compte de la complexité d’un cas, dans son contexte naturel, via la triangulation de plusieurs sources de données, et elle peut être réalisée de manière rétrospective (Rosenberg & Yates, 2007). En effet, l’étude Homère représente une opportunité de documenter les facilitateurs et les obstacles à la réalisation d’une recherche participative, en particulier dans le champ du handicap.
Les différents documents produits pour la conduite de l’étude, c’est-à-dire les documents de supports et les comptes rendus des différentes instances, ainsi que le journal de bord de suivi du projet, ont été utilisés comme sources de données. Ces documents, rédigés par des personnes de statuts différents, contiennent des informations très détaillées sur le déroulement de l’étude et reflètent la variété des modes de communications employés dans le projet. Par ailleurs, le journal de bord est une méthode qui permet de collecter sur le moment et de manière non intrusive des données pertinentes sur des événements et des réflexions (Bartlett & Milligan, 2015).
Cette étude respecte les principes éthiques de la recherche impliquant des sujets humains (World Medical Association, 2013).
Cadre participatif du déroulement de l’étude
L’étude Homère s’est déroulée entre 2019 et 2022, dans un contexte de crise sanitaire lié à la pandémie COVID 19. L’étude a été réalisée par un consortium de recherche constitué de deux équipes de recherche et de deux cabinets de conseil. Le budget total du projet était de près de de 210 000 euros, dont environ 150 000 euros dédiés à la réalisation de l’étude, et le reste à la valorisation des résultats.
Un comité de pilotage composé par des personnes de terrain et les équipes de recherche
Le collectif à l’origine de l’étude et impliqué dans le copilotage était composé de huit associations militantes ou gestionnaires d’établissements et d’une institution médico-sociale (voir Tableau 1 pour un récapitulatif des diverses instances de l’étude). Cinq partenaires, dont trois organismes à but non lucratif, un établissement public et une entreprise privée ont aussi participé au financement et rejoint le comité de pilotage de l’étude. Ainsi, ce dernier était composé des membres du consortium de recherche, de membres du collectif et des partenaires ; ces structures sont domiciliées dans plusieurs régions de France métropolitaine. Le collectif et les partenaires étaient coordonnés par une coordinatrice salariée d’une des associations du collectif.
Les réunions du comité de pilotage avaient lieu tous les 2 mois environ, principalement en visioconférence compte tenu des restrictions liées à la pandémie durant cette période. Les avancements récents étaient présentés, les étapes subséquentes discutées, et lorsque des freins avaient été identifiés, les ajustements à opérer étaient décidés.
Au niveau du consortium de recherche, des réunions de suivi avaient lieu toutes les deux semaines. Une cheffe de projet d’un des cabinets de conseil du consortium et la coordinatrice du collectif se réunissaient à intervalle régulier pour assurer l’avancement des différentes étapes de la recherche, et identifier sur le moment les freins à cet avancement. Ces réunions permettaient aussi de préparer chaque réunion du comité de pilotage. Chaque rencontre était actée avec des comptes rendus.
Enfin, les membres des différentes structures du collectif et des partenaires qui n’étaient pas présents dans le comité de pilotage pouvaient s’impliquer concrètement dans l’étude, en participant aux différentes étapes.
Tableau 1. Instances, composition et rôles dans l’étude Homère.
| Instance | Composition | Rôle |
| Comité de pilotage | Consortium de recherche : 2 équipes de recherche et de 2 cabinets de conseil | Définir les étapes de l’étude et suivre les avancements, choisir les ajustements à opérer |
| Collectif : 8 associations militantes ou gestionnaires d’établissements et 1 institution médico-sociale | ||
| Partenaires : 3 organismes à but non lucratif, 1 établissement public et 1 entreprise privée | ||
| Commission communication | Animée par un membre du consortium de recherche | Établir la stratégie de communication et sa mise en œuvre opérationnelle |
| Composée d’une dizaine de volontaires responsables communication des structures du collectif et des partenaires | ||
| Comité scientifique | Piloté par deux membres administrateurs d’associations du collectif | Rôle de conseil auprès du consortium de recherche, notamment pour le traitement des données |
| Composé de 5 chercheurs, 2 statisticiens, et 1 personne en charge du pilotage de la recherche dans le champ de l’autonomie |
Démarche participative pour le développement du questionnaire
Le questionnaire utilisé dans le cadre de l’étude a été conçu en plusieurs étapes (pour une description détaillée, voir Pigeon et al., 2023), impliquant au total 49 personnes, dont 20 ayant une déficience visuelle, 3 proches aidants, 28 professionnels dans le champ du handicap visuel (par exemple, instructrices de locomotion, assistantes sociales, psychologues), et 7 chercheuses et chercheurs. Certaines de ces personnes avaient également un handicap visuel ; et deux tiers n’étaient pas affiliées aux structures impliquées dans le collectif et les partenaires. Chaque personne contribuant au questionnaire pouvait participer à une ou plusieurs étapes de développement.
Le questionnaire a ensuite été programmé par des membres du consortium scientifique sur le logiciel d’enquête open source LimeSurvey qui offre des garanties d’accessibilité standard satisfaisantes et qui a permis un travail de développement supplémentaire pour assurer une accessibilité effective supérieure. Le questionnaire a été testé avec des personnes déficientes visuelles d’âge, de familiarité au numérique et de niveau de déficience visuelle variés, avec l’appui d’un expert ergonome du consortium lui-même déficient visuel et de ses étudiants. Un nouveau test a été réalisé par 33 personnes issues des membres du comité de pilotage, avec des profils variés en termes d’âge, de genre, de sévérité et d’âge de survenue de la déficience visuelle.
Le questionnaire a été développé, programmé et validé entre le 25 septembre 2020 et le 2 février 2021 (voir Tableau 2 pour un récapitulatif des étapes de l’étude).
Démarche participative de collecte de données
Le questionnaire a été diffusé en ligne entre le 11 février 2021 et le 30 juin 2022 suivant un plan de déploiement régional, d’abord durant quatre mois en région Auvergne-Rhône-Alpes (phase pilote). Les personnes répondantes des autres régions, identifiées sur la base de leur code postal, étaient invitées à se reconnecter pour compléter le questionnaire à une date ultérieure. La stratégie initiale était d’ouvrir le questionnaire pour une durée déterminée région après région, afin de concentrer les efforts de communication au niveau local. Néanmoins, considérant le nombre de connexions de personnes vivant hors de la région pilote, il a été décidé par le comité de pilotage d’ouvrir le questionnaire à toute la France métropolitaine durant la suite de la collecte. La stratégie de communication en région a été maintenue, notamment via l’organisation d’évènements de lancement régionaux, pour favoriser la visibilité du projet en ayant des relais de diffusion locaux. Une commission communication a été mise en place pour établir cette stratégie de communication et sa mise en œuvre opérationnelle. Animée par un membre du consortium de recherche, cette commission comprenait une dizaine de volontaires, principalement les responsables communication des structures du collectif et des partenaires. Les propositions élaborées par la commission communication étaient validées lors des réunions en comité de pilotage.
Dix évènements de communication en région ont été organisés (dont 3 en distanciels), impliquant des associations (y compris non membre du collectif) et des collectivités locales. Chacun de ces évènements était associé à une thématique abordée dans le questionnaire, à propos de laquelle des personnes ayant une déficience visuelle, des proches ou encore des professionnels étaient invités à témoigner. Un membre du consortium de recherche y présentait des éléments méthodologiques ou quelques résultats préliminaires. Des communiqués de presse co-signés par le collectif et les partenaires étaient diffusés en amont de ces évènements, pour relayer l’information dans les médias. De plus, chaque partie impliquée dans l’étude diffusait le questionnaire auprès de son réseau.
Les personnes répondantes pouvaient compléter le questionnaire elles-mêmes, ou aidées par un tiers, proche, bénévole ou professionnel. Par exemple, certaines associations ont mis à disposition des bénévoles pour aider au remplissage du questionnaire. Un document de suivi de collecte avec le nombre de personnes répondantes par région, tranche d’âge, genre, et canal de notoriété de l’étude était envoyé chaque semaine aux membres du comité de pilotage pour évaluer l’effet de chaque action de communication et ajuster les stratégies si nécessaire. Par exemple, pour dynamiser la collecte, il a été décidé de mettre en place un service de remplissage par téléphone, puis un remplissage en personne administré par des personnes en services civiques. Ce suivi permettait aussi de cibler la communication sur des profils sous-représentés, pour approcher la structure de l’échantillon final de la composition estimée de la population déficiente visuelle.
Démarche participative de traitement et d’analyse des données
Afin d’anticiper un délai de traitement court (moins de 4 mois, une personne à mi-temps, durant la période estivale), plusieurs démarches ont été réalisées en amont de la fin de la collecte de données.
Un comité scientifique a été mis en place, avec un rôle de conseil auprès du consortium de recherche, notamment pour le traitement des données. Ce comité scientifique était piloté par deux administrateurs d’associations du collectif, tous deux retraités et ayant fait carrière dans le milieu académique, l’un d’entre eux ayant une déficience visuelle. Le comité scientifique était composé de cinq chercheurs (dont deux retraités), deux statisticiens (dont une retraitée), et une personne en charge du pilotage de la recherche dans le champ de l’autonomie. Tous les membres du comité scientifique avaient une expertise en déficience visuelle, et la moitié en était atteinte. Six membres sur huit n’étaient pas impliqués dans le comité de pilotage de l’étude. Ce comité scientifique était sollicité, en partie ou au complet, en visioconférence, par téléphone ou par échange de courriels pour conseil ou validation à chacune des étapes de traitement.
Classification des personnes répondantes selon la sévérité de la déficience visuelle
Sur les conseils d’agents de la DREES, l’étude Homère comprenait une question issue des enquêtes Vie Quotidienne et Santé (VQS) menée à intervalle régulier depuis 1999, afin de permettre des comparaisons entre les enquêtes VQS et l’étude Homère, ayant des périmètres différents mais complémentaires. Cette question visait à estimer la sévérité de la déficience visuelle des personnes répondantes selon le niveau de difficulté déclaré pour voir avec des lunettes ou des lentilles de contact, si portées (un peu, beaucoup ou ne voit pas du tout). Cependant, de premières analyses de l’étude Homère ont mis en évidence la subjectivité trop importante de cette question.Par exemple, certaines personnes répondantes déclaraient avoir peu de difficultés pour voir et en même temps bénéficier du forfait cécité de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap), lire le braille, utiliser une canne blanche, ou avoir une acuité visuelle au meilleur œil inférieur ou égale à 1/10. En concertation avec trois membres du comité scientifique, puis validé en réunion de comité de pilotage, laclassification des personnes répondantes a été redéfinie en considérant les caractéristiques ophtalmologiques lorsque disponibles, et des caractéristiques fonctionnelles (par exemple, utiliser une aide technique pour lire ou se déplacer) ou administratives (par exemple, bénéficier du forfait cécité de la PCH).
Analyses de données
Afin d’augmenter la représentativité des résultats de l’étude Homère, les données recueillies ont été post-stratifiées sur la base des données françaises de l’enquête European Health Interview Survey de 2019-2020 (EHIS ; DREES, 2021). La procédure de pondération a été définie en concertation avec trois membres du comité scientifique.
Deux ateliers, animés par le consortium de recherche, ont été réalisés pour impliquer les membres du collectif et des partenaires dans l’analyse des données de l’étude.
Le premier a eu lieu durant la phase de recueil de données (18 février 2022) et visait à co-construire une feuille de route d’analyse de données. Initialement prévu en présentiel, cet atelier a été adapté la veille pour être réalisé en visioconférence en raison d’un préavis de grève. 14 personnes issues de 9 structures du collectif et des partenaires ont été réparties en fonction de leurs domaines d’expertise et d’intérêt en 2 groupes thématiques. Chaque groupe était animé par un membre du consortium ; un second membre était présent pour l’assister et pour la prise de note. Pendant 2h30, les 13 thématiques du questionnaire ont été abordées, et les personnes participant à l’atelier devaient identifier les enjeux soulevés et en tirer des préconisations d’analyse de données. Pour chaque thématique ou sous-thématique, il était demandé d’indiquer des croisements prioritaires (par exemple, par tranche d’âge, sévérité de la déficience visuelle, genre), et la pertinence d’une analyse de toutes les personnes répondantes (c’est-à-dire, quelle que soit la tranche d’âge ou la sévérité de la déficience visuelle). La feuille de route construite sur la base de cet atelier a ensuite été partagée à l’ensemble du comité de pilotage et suivie, lorsque les effectifs le permettaient, par le consortium de recherche pour les analyses présentées dans la première version du rapport de recherche.
Cette première version du livrable a été transmise en amont à 24 personnes participantes au second atelier (2 novembre 2022), réalisé en présentiel sur une durée de 5h, alternant des phases en groupes thématiques et en plénière. Les objectifs étaient de permettre aux membres des structures de terrain de s’approprier les résultats de l’étude, d’apporter leur expertise sur l’interprétation des résultats et de solliciter des modifications, par exemple, l’ajout d’analyses supplémentaires qui n’avaient pas été identifiées lors du précédent atelier. Le rapport de recherche a été amendé à la suite de cet atelier. Ainsi, alors que les membres du consortium étaient responsables des analyses et de la rédaction, le rapport final intégrait la participation de l’ensemble des personnes impliquées dans l’étude.
Démarche participative de valorisation des résultats
Bien que l’étude Homère soit terminée, la valorisation des résultats, au niveau académique et au-delà se poursuit.
La valorisation académique du projet a été portée par les équipes de recherche du consortium et a donné lieu, un an et demi après la fin du projet, à la publication d’un article dans une revue internationale indexée (Pigeon et al., 2023), et à une présentation avec actes dans une conférence nationale (Pigeon et al., 2024).
Le transfert des connaissances au-delà du monde académique était porté par le collectif, par le consortium, ou par les deux conjointement, et parfois en incluant le recours à des prestataires. À titre d’exemple, l’organisation d’un évènement de restitution, la synthèse du livrable, une infographie associée, des vidéos, ainsi que trois cahiers thématiques ont été réalisés par des membres du consortium et du collectif. Un module interactif qui présente les principaux résultats de l’étude a quant à lui été réalisé par le collectif. Les équipes scientifiques sont également régulièrement invitées à présenter des résultats lors d’évènements organisés par les structures de terrain. L’étude a également bénéficié d’une couverture médiatique (radio, presse écrite, site d’information spécialisé), principalement porté par les membres du collectif, et par les équipes de recherche.
Tableau 2. Description des étapes de l’étude et de leur nature participative ; à noter que toutes les étapes étaient validées, suivies et ajustées au besoin par le Comité de pilotage.
| É t ape | Description | Nature participative |
| D é veloppement du questionnaire | Création du questionnaire : questions, ordre de passation et filtres conditionnels | Implication de personnes de terrain (ex. : personnes concernées, professionnels) dans la création du questionnaire et les tests d’accessibilité |
| Programmation sur LimeSurvey | ||
| Test d’accessibilité | ||
| Collecte de donn é e s | Organisation d’évènements de lancement en région | Collecte de données portée par la commission communication composée de membres des structures du collectif et des partenaires |
| Diffusion du questionnaire dans les différents réseaux | ||
| Traitement et analyse de donn é es | Classification des répondants etpondération des données | Sollicitation du comité scientifique pour la classification des répondants et la pondération des données |
| Identification de croisements à analyser | Réalisation de deux ateliers impliquant des membres des structures du collectif et des partenaires pour identifier les croisements pertinents et amender le rapport | |
| Analyses statistiques | ||
| Valorisation des r é sultats | Publication d’articles académiques | Transferts de connaissance porté ou co-porté par le collectif |
| Transfert de connaissance : évènement de restitution, synthèse, infographie, vidéos, cahiers thématiques, module interactif |
Discussion
Le présent article détaille les modalités de participation à l’étude Homère des acteurs et actrices du champ de la déficience visuelle et des personnes concernées, étape par étape. Cette analyse permet d’identifier des forces et des défis de la démarche participative dans le contexte de cette étude, et de suggérer des recommandations susceptibles d’être appliquées à d’autres études participatives.
En ce qui concerne les points forts de l’étude, l’engagement du collectif, des partenaires et plus généralement des personnes concernées a tout d’abord permis le développement d’un questionnaire pertinent tant sur le fond que sur la forme. En effet, puisque la problématique de recherche est elle-même issue du terrain, le questionnaire aborde les enjeux affectant directement la vie quotidienne des personnes ayant une déficience visuelle. Dès le début du projet, cette démarche participative a aussi garanti l’accessibilité optimale du questionnaire aux personnes aveugles utilisant un lecteur d’écran et aux personnes malvoyantes utilisant ou non des outils de compensation numérique. Le questionnaire était également construit pour permettre à des personnes voyantes d’assister les personnes répondantes durant la complétion.
L’implication en première ligne du collectif et des partenaires dans la diffusion du questionnaire est une autre force du projet. Les structures se sont investies à la fois individuellement, en diffusant l'information par leurs canaux habituels, et collectivement, en travaillant ensemble à la promotion de l'étude, notamment au sein la commission communication. D’ailleurs, 42,7 % des personnes répondantes de 16 ans et plus ne sont pas adhérentes à une association du champ de la déficience visuelle, témoignant d’efforts de diffusion au-delà des structures spécialisées en déficience visuelle.
De plus, la participation des membres des structures de terrain dans le pilotage de l’étude a permis d'apporter des adaptations au projet en se basant sur leur expertise de terrain. Ces différents points ont pu être des facteurs considérables de l’obtention d’une taille d’échantillon de 2201 personnes répondantes, comparable à celui de personnes déficientes visuelles interrogées dans l’enquête Handicap Incapacité Dépendance (HID) conduite en 1999 (Mormiche, 1998). L’exploitation de l’enquête HID concernant les personnes avec une déficience visuelle vivant en domicile ordinaire portait sur 2274 personnes déficientes visuelles, dont 88 personnes aveugles, 1131 personnes malvoyantes et 1055 personnes atteintes d’autres troubles de la vision (Sander et al., 2005). L’enquête HID dans son ensemble avait mobilisé des moyens incomparables à ceux de l’étude Homère, puisque la collecte des données reposait sur plus de 400 enquêteurs et enquêtrices de l’INSEE (Mormiche, 2003).
Enfin, un autre point fort est que l’étude Homère a pu rassembler, dans un même cadre de travail, une équipe transdisciplinaire constituée de personnes du domaine associatif, de personnes de terrain et d’équipes académiques qui ont appris à se connaître, à collaborer, et à reconnaître l’intérêt et la valeur ajoutée du travail participatif. La recherche participative apporte des opportunités d’apprentissage bidirectionnelles et transdisciplinaires entre recherche et terrain (Hermesse & Vankeerberghen, 2020). De plus, tisser des relations privilégiées entre le terrain et la recherche est essentiel pour la réussite de futures recherches participatives (Latulippe et al., 2023). Ainsi, l’expérience de l’étude Homère a conduit certaines des parties impliquées, rejointes par d’autres actrices et acteurs du domaine, à rédiger et remporter un appel à projet pour soutenir la structuration d’une Communauté mixte de recherche sur les déficiences visuelles. L’objectif de cette communauté est de mettre en réseaux à l’échelle nationale les personnes de terrains et les équipes de recherche du champ pour favoriser l’interconnaissance, la transdisciplinarité, professionnaliser les relations et promouvoir la recherche participative dans le contexte de la déficience visuelle.
Pour autant, le processus participatif de l’étude Homère n’a pas été sans défis. Sur la question de la temporalité, des disparités d’approches ont été observées entre le collectif et le consortium de recherche. Par exemple, au sujet de la durée des phases, la création du questionnaire et l’analyse des données, ont été particulièrement courtes, alors même que cette étape requiert un travail opérationnel conséquent, et un temps de réflexion bénéfique pour une prise de recul. Malgré des négociations qui ont permis de prolonger ces deux phases de quelques semaines, certains membres du consortium de recherche ont dû consacrer un temps de travail hebdomadaire plus important que ce qui était initialement contractualisé. Du côté du terrain, il est nécessaire que la concrétisation de l’étude et la diffusion des résultats puissent se faire au plus vite pour favoriser son étendue et son impact sociétal.
Un autre contraste de positions concernait les demandes en amont de la collecte de projection de la part du collectif sur un nombre de personnes répondantes attendues, auxquelles le consortium de recherche ne pouvait répondre en raison de la nature inédite de l’étude et du mode de collecte en ligne.
La recherche participative soulève également des questions sur la posture de la chercheuse ou du chercheur. En adoptant les principes de la démarche participative, la chercheuse ou le chercheur renonce à avoir le contrôle exclusif du processus de recherche. Toutefois, les rapports de pouvoir peuvent s’inverser au point qu’une relation de prestation peut progressivement s’instaurer. Dans l’étude Homère, la composition du consortium de recherche a pu contribuer à complexifier les relations entre recherche et terrain. En effet, la moitié était constituée de cabinets de conseil privés, ayant des pratiques, des postures et des réalités économiques distinctes de celles des laboratoires universitaires. Par ailleurs, la question de la source de financement de l’étude est un autre élément pouvant influer ces relations. Pour initier l’étude, le collectif à son origine n’avait pas eu d’autres moyens que de l’auto-financer.
La pandémie COVID-19 a posé un défi supplémentaire lors de l’étude Homère. Presque toutes les rencontres du comité de pilotage ont eu lieu en visioconférence, un mode de collaboration qui complique le développement de relations de confiance entre les parties qui ne se connaissant pas au départ. De plus, les dynamiques de diffusion informelles, telles que le bouche-à-oreille, ont pu être fortement limitées en raison de l’absence de contacts en personne au sein des structures et services de terrain à certaines périodes de la diffusion du questionnaire.
La première recommandation pour de futurs projets de recherche participative, tirée de cette analyse, est de prévoir un temps spécifique et un budget associé en début de projet pour permettre aux différentes parties impliquées de mieux se connaître, notamment en ce qui concerne leurs besoins et contraintes mutuelles. Ce temps devrait permettre de définir les rôles et les limites de chacun, ainsi que d’identifier les modalités d’interaction à utiliser, y compris les outils de communication, notamment pour les besoins d’accessibilité particuliers. La co-création d’une charte pourrait servir de base pour structurer cette phase de préparation.
De plus, dans le cadre d’une telle étude, la présence de partenaires publics en tiers participants à la recherche pourrait être une force considérable, notamment pour la récolte de données représentatives de la population d’intérêt, par exemple via une collaboration avec les MDPH (Maisons Départementales pour les Personnes Handicapées).
Enfin, pour éviter l’établissement d’une relation de prestataire entre les membres de terrain et les équipes de recherche, et assurer l’intégrité de la démarche participative, il est crucial que la recherche participative ne soit pas financée par les structures de terrain à l’origine de la demande, mais plutôt par des organismes de financement tiers et indépendants. Malgré l’essor de dispositifs de financement orientés sur la recherche participative, tels que le programme Autonomie de l’Institut pour la Recherche en Santé Publique (IReSP), financé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), l’appel à projets Science avec et pour la société de l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR), et les appels à projets annuels de la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH), il est nécessaire de continuer à promouvoir des mécanismes de financement qui garantissent une véritable collaboration entre sciences et société. Il est également essentiel que les appels à projet de recherche compétitifs reconnaissent et valorisent les spécificités des projets de recherche participative, qui peuvent ne pas suivre le même rythme de publications que les projets plus traditionnels, afin de garantir leur viabilité et leur pertinence dans le contexte des besoins réels des personnes concernées et de terrain.
En conclusion, en présentant certains succès et défis rencontrés dans l’étude Homère, cet article peut contribuer à la réflexibilité nécessaire dans le champ de la recherche participative (Bertrand & Petiau, 2023). Une perspective intéressante de ce travail pourrait être l’examen des effets à moyen et à long terme de l’étude Homère sur la vie quotidienne des personnes concernées, notamment en termes de changements dans les pratiques des structures de terrain et des professionnels, d'amélioration de l'accessibilité physique et numérique, d'évolution des représentations de la société sur la déficience visuelle, et d’effet sur les politiques publiques.
Remerciements
Les auteurs remercient toutes les personnes et les structures impliquées dans l’étude Homère, ainsi que l’ensemble des répondants au questionnaire. Merci également aux stagiaires qui nous ont assistés dans la création du questionnaire ou dans la mise en forme des données. Leur aide a été précieuse.
L’étude Homère a été en partie financée par le collectif composé des structures suivantes : l’Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles (ANPEA), l’Association Valentin Haüy (AVH), la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France (FAAF), la Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC), le Groupement des Associations Partenaires d’Action Sociale (GAPAS), l’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA), l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Rhône et de la Métropole de Lyon (Les PEP 69/Métropole de Lyon), RETINA France et Voir Ensemble. L’étude a aussi été financée par les partenaires suivants : l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH), la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (Cnav), Klésia et Optic 2000.
Références
Anadón, M. (2007). Recherche participative : Multiples regards (1re éd.). Presses de l’Université du Québec. https://doi.org/10.2307/j.ctv18ph9tc
Assi, L., Chamseddine, F., Ibrahim, P., Sabbagh, H., Rosman, L., Congdon, N., Evans, J., Ramke, J., Kuper, H., Burton, M. J., Ehrlich, J. R., & Swenor, B. K. (2021). A Global Assessment of Eye Health and Quality of Life: A Systematic Review of Systematic Reviews. JAMA Ophthalmology. https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2021.0146
Augestad, L. B. (2017). Mental Health among Children and Young Adults with Visu-al Impairments: A Systematic Review. Journal of Visual Impairment & Blind-ness, 111(5), 411‑425. https://doi.org/10.1177/0145482X1711100503
Barnes, C. (2003). What a Difference a Decade Makes: Reflections on doing ‘eman-cipatory’ disability research. Disability & Society, 18(1), 3‑17. https://doi.org/10.1080/713662197
Bartlett, R., & Milligan, C. (2015). What Is Diary Method? Bloomsbury Academic.
Bell, E. C., & Silverman, A. M. (2018). Rehabilitation and Employment Outcomes for Adults Who Are Blind or Visually Impaired: An Updated Report. Journal of Blindness Innovation and Research, 7(1). http://dx.doi.org/10.5241/8-148
Bertrand, K., & Petiau, A. (2023). Les défis de la recherche participative : Au-delà des bonnes intentions. Santé Publique, 35(HS2), 7‑11. https://doi.org/10.3917/spub.hs2.2023.0007
Burton, M. J., Ramke, J., Marques, A. P., Bourne, R. R. A., Congdon, N., Jones, I., Ah Tong, B. A. M., Arunga, S., Bachani, D., Bascaran, C., Bastawrous, A., Blan-chet, K., Braithwaite, T., Buchan, J. C., Cairns, J., Cama, A., Chagunda, M., Chuluunkhuu, C., Cooper, A., … Faal, H. B. (2021). The Lancet Global Health Commission on Global Eye Health: Vision beyond 2020. The Lancet. Global Health, 9(4), e489‑e551. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30488-5
Conseil de l’Europe. (2023). La décision sur le bien-fondé dans Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe c. France, réclamation n° 168/2018, est désormais publique—Droits sociaux—Www.coe.int. Droits so-ciaux. https://hudoc.esc.coe.int/fre/?i=cc-168-2018-dmerits-fr
Douglas, G., Pavey, S., Corcoran, C., & Clements, B. (2012). Evaluating the use of the ICF as a framework for interviewing people with a visual impairment about their mobility and travel. The British Journal of Visual Impairment, 30(1), 6 21. https://doi.org/10.1177/0264619611428932
DREES. (2021). Indicateurs EHIS [Jeu de données]. https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/explore/dataset/indicateurs-ehis/information/
DREES. (2023). Enquête Vie quotidienne et santé 2021. Données détaillées.
Fougeyrollas, P., Cloutier, R., Bergeron, H., Côté, J., & St-Michel, G. (Éds.). (1998). The Quebec Classification: Disability Creation Process. International Network on the Disability Creation Process; Canadian Society for the International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps.
Hermesse, J., & Vankeerberghen, A. (2020). La recherche transdisciplinaire au sein des institutions d’enseignement supérieur et de recherche. Natures Sciences Sociétés, 28(3‑4), Article 3‑4. https://doi.org/10.1051/nss/2021006
Houllier, F., & Merilhou-Goudard, J.-B. (2016). Les sciences participatives en France. États de lieu, bonnes pratiques et recommandations. https://doi.org/10.15454/1.4606201248693647E12
Jones, G. C., Crews, J. E., & Danielson, M. L. (2010). Health risk profile for older adults with blindness : An application of the International Classification of Functioning, Disability, and Health framework. Ophthalmic Epidemiology, 17(6), 400‑410. https://doi.org/10.3109/09286586.2010.528137
Kitchin, R. (2000). The Researched Opinions on Research: Disabled people and disa-bility research. Disability & Society, 15(1), 25‑47. https://doi.org/10.1080/09687590025757
Latulippe, K., Tessier, A., Routhier, F., Raymond, É., Fiset, D., Corcuff, M., & Archam-bault, P. S. (2023). Facilitators and challenges in partnership research aimed at improving social inclusion of persons with disabilities. Disability and Reha-bilitation, 46(5), 957–968. https://doi.org/10.1080/09638288.2023.2188264
le Défenseur des droits. (2020). La mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) (p. 109). le Défenseur des droits.
LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la par-ticipation et la citoyenneté des personnes handicapées, 2005-102 (2005).
Mormiche, P. (1998). L’enquête HID de l’Insee. Objectifs et schéma organisationnel. Courrier des Statistiques, 87-88.
Mormiche, P. (2003). L’enquête « Handicaps, incapacités, dépendance » : Apports et limites. Revue française des affaires sociales, 1, 11 29. https://doi.org/10.3917/rfas.031.0011
Northway, R. (2010). Participatory research. Part 1: Key features and underlying philosophy. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 17(4), 174‑179. https://doi.org/10.12968/ijtr.2010.17.4.47300
Nyström, M. E., Karltun, J., Keller, C., & Andersson Gäre, B. (2018). Collaborative and partnership research for improvement of health and social services: Re-searcher’s experiences from 20 projects. Health Research Policy and Systems, 16(1), 46. https://doi.org/10.1186/s12961-018-0322-0
Oliver, M. (1992). Changing the social relations of research production? Disability, handicap & society, 7(2), 101‑114. https://doi.org/10.1080/02674649266780141
Organisation des Nations Unies. (2006). Convention relative aux droits des per-sonnes handicapées. https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
Organisation Mondiale de la Santé. (2001). Classification internationale du fonc-tionnement, du handicap et de la santé : CIF. Organisation mondiale de la Santé.
Pigeon, C., Galiano, A. R., Afonso-Jaco, A., Valente, D., Uzan, G., Prestini, M., & Bal-tenneck, N. (2023). A participatory research to design a survey providing a portrait of the life of people with visual impairments. Disability & Society. https://doi.org/10.1080/09687599.2023.2287413
Pigeon, C., Galiano, A. R., Evennou, M., Uzan, G., & Baltenneck, N. (2024, juin). Usage d’internet des personnes atteintes d’une déficience visuelle et ses dé-terminants : Exploitation des données de l’étude Homère. Handicap 2024, IFRATH, Paris, France. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04604666
Priestley, M., Waddington, L., & Bessozi, C. (2010). New priorities for disability re-search in Europe : Towards a user-led agenda. Alter, 4(4), 239‑255. https://doi.org/10.1016/j.alter.2010.07.001
Reason, P., & Bradbury, H. (2008). Handbook of action research: Participative in-quiry and practice. Sage publication.
Renaud, J., & Bédard, E. (2013). Depression in the elderly with visual impairment and its association with quality of life. Clinical Interventions in Aging, 8, 931-943. https://doi.org/10.2147/CIA.S27717
Rosenberg, J. P., & Yates, P. M. (2007). Schematic representation of case study re-search designs. Journal of Advanced Nursing, 60(4), 447‑452. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04385.x
Sander, M.-S., Bournot, M.-C., Lelièvre, F., & Tallec, A. (2005). La population en si-tuation de handicap visuel en France : importance, caractéristiques, incapaci-tés fonctionnelles et difficultés sociales. Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-09/handicapvisuel.pdf
Simui, F., Kasonde-Ngandu, S., Cheyeka, A. M., Simwinga, J., & Ndhlovu, D. (2018). Enablers and disablers to academic success of students with visual impair-ment: A 10-year literature disclosure, 2007–2017. British Journal of Visual Impairment, 36(2), 163‑174. https://doi.org/10.1177/0264619617739932
World Medical Association. (2013). World medical association declaration of Helsin-ki: Ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA, 310(20), 2191‑2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053
Téléchargements
Publiée
Rubrique
Comment citer
Licence
Certains droits réservés 2024 Caroline Pigeon, Dannyelle Valente, Nicolas Baltenneck, Gérard Uzan, Anna Rita Galiano

Ce travail est disponible sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International .